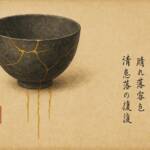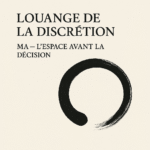Quatre mois intenses, condensés en 7 minutes de lecture : un format “convenient store”, comme au Japon. Rapide, mais riche et varié, avec tout ce qu’il faut pour nourrir l’esprit avant de reprendre la route.
Le café fume encore, posé sur la table de marbre. Le jardin de la Mamounia s’étire comme un poème ancien, palmiers dressés, orangers en prière, lumière ocre qui caresse chaque feuille. Nous sommes dimanche, 24 août. Tout paraît immobile et pourtant tout frémit : c’est le seuil d’une rentrée. Je sens monter ce mélange d’appréhension et de joie, comme avant un lever de rideau. Mais cette fois, je ne veux pas jouer le rôle du Sisyphe épuisé : je veux réinventer la scène, l’éclairer de joie et de légèreté.
Depuis mai, mon être n’a plus la même texture. Il s’est brisé, puis recomposé en fragments. J’ai commencé par écrire sur la victoire la plus rude, celle qu’on ne fête pas : la victoire sur soi-même. Non pas un triomphe visible, mais une lucidité nue, presque brutale. Puis il y eut la page blanche, ce vertige qui oblige à respirer autrement, à poser le premier mot comme on pose le premier pas. Ensuite vint le pivot, ce pardon qu’on s’accorde quand un plan figé devient prison : renoncer, se libérer, recommencer autrement.
Puis j’ai appris, ou presque, la discrétion. Le ma, cet intervalle entre deux gestes, m’a montré que le vide est parfois plus fertile que le plein. Et j’ai regardé mes fissures autrement : non plus comme des cicatrices à cacher, mais comme des lignes dorées, en braille sensible, qui révèlent une histoire. Le kintsugi m’a appris qu’on peut habiter ses brisures, en faire des nervures précieuses.
J’ai connu aussi le trop-plein, ce moment où le corps rappelle sa fragilité. Là, le mot hamdoulah a pris toute sa place de sauveur : gratitude pour chaque souffle rendu, pour chaque tension apaisée. J’ai compris que la réussite ne se mesure pas seulement dans les bilans, mais aussi dans la douceur d’un regard tendu à la vie.
Avec Hobbes et Smith, j’ai interrogé mes instincts et mon éthique. J’ai fait le choix du loup fidèle plutôt que du prédateur, j’ai accueilli en moi ce spectateur impartial qui veille en silence : serais-je fier de moi si je me regardais comme un autre ? Ce fut un ancrage moral, discret mais nécessaire. Et j’ai accepté de suspendre, avec un non-article, la tyrannie du rationnel : flotter, dériver, respirer.
Puis, dans la lumière de la fidélité, j’ai marché en blanc à Tétouan, parmi des centaines de dignitaires. Ce n’était pas seulement un honneur personnel, mais un souffle collectif, un pacte ancien renouvelé. Je l’ai dédié à ma fille, aux jeunes, à mes collègues et à mes partenaires. Ce fut un rappel : la fidélité n’est pas contrainte, elle est racine et elle est à soi-même.
Début août, j’ai ri de moi-même avec un Curriculum Vite Fait, fait d’arnaques involontaires et de mesures de fin de mois. J’ai compris que nos vrais diplômes peuvent être mesurés à la taille de nos cicatrices, mais aussi dans les fidélités tenues et les nuits blanches traversées. Et avec Picasso, Nietzsche, Sénèque, j’ai découvert que la jeunesse n’est pas derrière nous : elle est à retrouver, légère, après la tempête.
Et puis il y eut le Japon. Tokyo et ses foules disciplinées, Osaka et ses excès gourmands, Kyoto et ses temples silencieux, Fuji la pudique qui se cache pour mieux se révéler. Là-bas, j’ai vu la justesse d’un geste, la beauté d’une transmission, la dignité d’une fêlure soulignée d’or. J’ai été saisi par le sentiment que vacance et labeur ne sont pas antipodes : ils respirent ensemble, comme inspiration et expiration, contemplation et action. Barthes, que je me suis remis à relire, me souffle à nouveau que la tragédie de l’amoureux est l’attente d’un signe ; moi, j’ai tranché, cette décision que j’appréhendais après le périple nippon : entreprendre mon amour pour la vie ; et, chemin faisant, réanimer mon amour d’entreprendre. Non plus entreprendre pour combler un vide, ni pour répondre à une attente, mais entreprendre avec Purpose : avec la conviction intime que chaque projet, chaque geste, chaque alliance peut devenir une manière d’aimer, de donner sens, et de faire de nos labeurs une fête partagée.
Et me voici ce matin, à la Mamounia. Le café refroidit doucement, le jardin bruisse d’un silence ancien. Tous ces fragments se rassemblent. Je ne reviens pas pour prouver, mais pour partager. Pas pour courir après des pistes, mais pour tracer des jalons.
Alors je formule ici, dans ce jardin, un vœu. Que l’avenir m’offre la sincérité et la gentillesse, cette double sève qui donne aux racines humaines leur élan juste. Qu’elles s’enveloppent dans un nuage de légèreté. Qu’elles nourrissent les plaies, comme on arrose un jardin, pour y faire pousser l’espérance. Qu’elles rappellent que la vie, même brisée, peut se recoller autrement, plus douce, plus féconde.
Alors, je repose ma tasse. Le café s’est refroidi, mais le jour s’ouvre, clair : une rentrée comme une fête. Une fête du travail, une fête du souffle, une fête des joies retrouvées.
Pour ceux qui se demandent ce que cache mon clin d’œil au “7-Eleven” : un convenient store est une petite supérette ouverte jour et nuit, que l’on trouve à chaque coin de rue au Japon. On y entre pour quelques minutes, on en ressort avec de quoi tenir la journée : un onigiri, un café, un carnet, une recharge téléphonique… Plus qu’un commerce, c’est devenu un culte discret, une extension de la vie quotidienne japonaise. Rapide, accessible, mais étonnamment riche et varié. Voilà pourquoi j’y ai vu une métaphore de ces quatre mois condensés en 7 minutes de lecture.